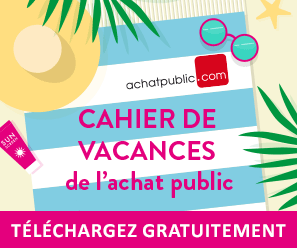Dialoguer pour informer les titulaires étrangers
- 18/07/2008
Méconnaissance de la législation applicable en France, droit du pays d’origine plus favorable ….Les entreprises étrangères titulaires de marchés en France peuvent avoir la tentation de faire rentrer le contrat dans le cadre juridique applicable chez eux. Pour tuer le conflit dans l’œuf, le dialogue et la concertation sont les outils impensables d’une collectivité publique. Fabrice Mazouni, ingénieur à la direction de l’écologie urbaine de la CUD, nous fait part de son expérience en la matière.

Une des clés du bon déroulement d’un marché public attribué à une entreprise étrangère réside dans le dialogue et les échanges. Certes cet élément est important lorsque le titulaire est français, mais il devient essentiel en cas de titulaire ne résidant pas en France, lequel peut avoir tendance à interpréter les règles au regard de la législation applicable dans son pays. Cette situation, la communauté urbaine de Dunkerque (CUD) l’a rencontrée à l’occasion d’un marché pour la réalisation d’un centre de valorisation organique attribué à une entreprise suisse. Début des années 2000, la CUD a lancé un appel d’offres européen sur performance pour la réalisation d’un centre de compostage. « A l’époque, nous avons reçu trois offres, dont une d’une entité suisse. Cette société a répondu en groupement avec un architecte de Dunkerque et une entreprise de génie civile française. Le type de technologie était peu répandu à l’époque, peu d’entités nationales en disposaient, nous nous doutions donc que des professionnels de secteur au niveau européen ou hors zone euro allaient répondre. C’est pourquoi nous avons inséré dans le cahier des charges des clauses spécifiques aux candidats étrangers », explique Fabrice Mazouni, ingénieur à la direction de l’écologie urbaine de la CUD.
La concertation : un élément essentiel de l’exécution du marché
Pour ce marché, le cahier des charges exigeait que les documents contractuels et les pièces de travail soient rédigés en français ou accompagnés d’une traduction. « Nous n’avons pas fait retraduire les certifications. Comme nous étions sur un projet très normatif (utilisation de telle matière, tel degré de qualité du compost…), il aurait été risqué pour le candidat de fournir un document qui soit faux. En outre, s’il avait pris le risque, il aurait pu voir le marché résilié à ses torts », précise Fabrice Mazouni. Les critères de sélection des offres reposaient notamment sur des objectifs à atteindre et sur le prix. « Sur la base de ces critères, la commission spéciale a choisi la société suisse. Dans l’application le fait qu’une société suisse soit accompagnée des sociétés françaises rassure la collectivité locale sur le projet architectural ainsi que sur la qualité et les normes mises en œuvre en termes de travaux publics », remarque-t-il. Si la sélection du titulaire n’a pas posé de problème, il y a eu quelques couacs lors de l’exécution. « Il y a eu lors de cette phase, quelques décalages entre les notions de marchés que nous avons l’habitude de gérer au niveau français et leur interprétation de la part de nos amis suisses.
La tentation a parfois été grande d’interpréter certaines dispositions du cahier des charges en leur faveur. Je pense par exemple à la garantie de parfait achèvement ou encore à certains aspects du DCE », raconte Fabrice Mazouni. Le problème est que nos voisins européens ou hors union européenne ne maîtrisent pas toujours bien la législation applicable aux marchés publics. En effet, certaines obligations liées à la culture et à la pratique des marchés publics n’existent pas dans les autres pays. Ces différences ont été source de difficultés dans la mise en œuvre du projet de la CUD. « La collectivité a été ferme. Il y a eu quelques tergiversations, mais au final le « conflit » s’est soldé de façon satisfaisante. Les concertations et les réunions supplémentaires ont alourdi l’ensemble de la procédure. Mais cela était nécessaire pour une bonne exécution du marché », déclare-t-il. Il ajoute qu’ « il est primordial de continuer à parler et d’échanger sur l’interprétation et sur les termes des textes que nous avons l’habitude de pratiquer. La discussion a également été nécessaire pour mettre en place les modalités de versement des acomptes ».


Envoyer à un collègue
Juriste conseil et contentieux de la commande publique (f/h)
- 02/09/2025
- Département des Hauts-de-Seine
Juriste affaires générales et achats publics (f/h)
- 02/09/2025
- Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence
Responsable finances et commande publique (f/h)
- 02/09/2025
- Ville du Pellerin
TA Cergy-Pontoise 2 juillet 2025 Société Le Vigilant Sécurité Privée
-
Article réservé aux abonnés
- 05/09/25
- 07h09
TUE 23 juillet 2025 BT Global Services Belgium
-
Article réservé aux abonnés
- 04/09/25
- 07h09
TA Melun 24 juin 2025 Société OSB
-
Article réservé aux abonnés
- 03/09/25
- 11h09
Validation d’un critère environnemental évaluant la politique générale des candidats à un marché public
-
Article réservé aux abonnés
- 02/09/25 06h09
- Mathieu Laugier
Acheteur public : un métier sous tensions, selon la Commission d’enquête du Sénat
-
Article réservé aux abonnés
- 03/09/25 06h09
- Jean-Marc Joannès
Attributaire déchu d’un marché public : le classement des soumissionnaires à revoir ?
-
Article réservé aux abonnés
- 04/09/25 06h09
- Mathieu Laugier
Top 3 des méthodes pour repenser la commande publique !
-
Article réservé aux abonnés
- 29/08/25 06h08
- Johanna Granat