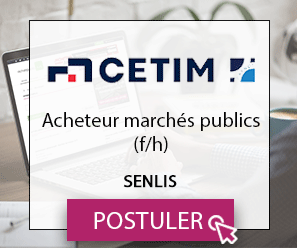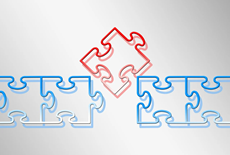L’allotissement des marchés publics : l'éternel débat franco-français

« Les Français ne sont pas des râleurs, ils râlent par amour du débat et par idéalisme »
Fanny Auger
Fanny Auger
Le principe d’allotir une opération en commande publique se voit de nouveau effrité par la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, qui autorise les pouvoirs adjudicateurs concernés à s’en défaire (relire " Industrie nucléaire : dérogations à la commande publique)".
Une dérogation qui concerne une infime poignée d’acheteurs publics, certes ... Mais elle s’inscrit dans une tendance de ces dernières années qui tend à réduire la portée de cette règle.
Un assouplissement du législateur et du juge
En effet, soit le législateur sort les acteurs publics de ce champ en faisant des lois dites sectorielles. Exemple : la loi n° 2023-1269 du 27 décembre 2023 qui prévoit que l'établissement public "Société des grands projets" et sa filiale compétente peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l'aménagement des infrastructures pour lesquelles l'établissement public ou sa filiale a été désigné maître d'ouvrage (relire"Services express régionaux métropolitains : un nouveau marché global").
Mais également des lois de circonstances, comme la loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 et son ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023, qui autorise les collectivités publiques victimes de dégradation lors des émeutes de l'été dernier, à s'affranchir de cette obligation (relire "Reconstruction en urgence : la commande publique assouplie pendant 9 mois").
Soit, les parlementaires multiplient les montages sous forme de marchés globaux particuliers offerts par le code de la commande publique, tout en assouplissant les conditions de recours,à l’instar du marché global de performance. Le principe d’allotissement est de fait mis à mal (CCP, art. L2171-1). Pas d’allotissement qu’il soit technique… mais aussi géographique (relire "Le marché global de performance mis à l'honneur").
Par ailleurs, en autorisant les offres variables, la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, affaiblit cette idée de diviser une opération en plusieurs lots (même si cette faculté est ouverte seulement aux entités adjudicatrices et pour une opération a minima de 10 millions d’euros) (relire "Offre variable : entre opportunité et complexité").
Quant aux juges, ces derniers temps, ils se montrent assez souples lorsqu’il s’agit d’y déroger pour les marchés "classiques". Le tribunal administratif (TA) de Paris admet le recours à un marché global car l’établissement public n’avait pas les moyens pour coordonner les différents prestataires (relire "Marché global : dérogation au principe d’allotissement en cas d’incapacité d’assurer la coordination").
Bien que la prestation se prêtait à la dévolution en lot, le ministère de l’Intérieur est arrivé à convaincre aussi cette juridiction des méfaits de l’allotissement pour le déroulé de son accord-cadre relatif à la fourniture et à la distribution d'effets d'habillement, d'accessoires et d'équipements individuels destinés aux personnels de la gendarmerie nationale, de la police nationale ainsi qu'aux hauts fonctionnaires (relire" Un recours au marché global de fourniture validé malgré des prestations distinctes").
Le magistrat de Poitiers reconnaît qu’un allotissement d’un marché de fournitures de deux unités mobiles de déshydratation des boues par presse à vis… risque de rendre techniquement plus difficile son exécution (relire "Interaction entre les prestations d’un marché public : dérogation au principe d’allotissement accordé").
La CAA de Nancy rejette la requête d’un candidat évincé qui considérait que la région Bourgogne-Franche-Comté aurait dû prévoir un lot pour les espaces numériques de travail (ENT) dédiés au premier degré et un autre lot pour les ENT dédiés au second degré (relire "Prestations distinctes et allotissement ne sont pas toujours de bon aloi").
Le TA de la Martinique juge qu’une prestation qui s’exécute sur plusieurs sites est un fait qui ne permet pas en soi de contraindre l’acheteur public à faire un allotissement géographique (relire" Exécution sur plusieurs sites : l’allotissement géographique pas justifié").
A la recherche d'un équilibre
Comment interpréter cet affaiblissement du principe d’allotissement ? Tout d’abord, au niveau européen, la directive « Marché public » encourage seulement à diviser en lots les marchés importants. Il faut donc se plonger dans les archives du droit des marchés publics, pour trouver des réponses... et y voir un mouvement franco-français qui ne cesse d’osciller entre contrainte et incitation.
C'est à compter de la loi du 31 janvier 1833 et des ordonnances royales du 4 décembre 1836 et du 14 novembre 1837 que les collectivités publiques ont l'obligation de faire une publicité et une mise en concurrence lorsqu'elles passent un marché public (à noter que la notion de marché public était beaucoup plus restrive à cette époque). Se pose très vite la question de l'allotissement. Dans un décret du 4 juin 1888, l’Etat est invité autant que possible à diviser en plusieurs lots ses marchés publics. Sous Vichy, le décret n°1082 du 6 avril 1942 érige l’allotissement en principe. A partir de la IVème République et durant une bonne partie de la Vème, sa portée s’étiole avec le décret n° 56-256 du 13 mars 1956 et les textes suivants, puisque l’allotissement devient obligatoire dès lors que le découpage de l’opération s’avère plus avantageux qu’un marché global.
Au début du XXIème siècle, c'est le grand écart, l’allotissement passe d’une simple possibilité avec le code des marchés publics de 2001, à une obligation sous le code des marchés publics de 2006. Principe pour l’heure toujours maintenu par le Code de la commande publique (CCP, art. L. 2113-10), même si, comme on l’a vu, les exceptions se multiplient (relire "[Dessine-moi la commande publique] Devez-vous allotir ?").
L’allotissement est donc un sujet qui fait débat depuis la fin du XIXème siècle. « [O]n ne saurait établir de règle absolue en pareille matière et que la meilleure solution à adopter dans chaque cas dépend des circonstances. C’est ainsi qu’il peut y avoir avantage pour l’Administration à ce que le constructeur d’un grand pont métallique soit en même temps chargé de l’établissement des piles et des culées en maçonnerie, bien que ce travail n’ait évidemment aucun rapport avec ceux que l’on exécute dans les ateliers de constructions mécaniques ».
Mais le « groupement en un seul lot de travaux de nature différente […] ce groupement empêche beaucoup [d’entreprises], dans une situation moyenne, de prendre part aux adjudications ». Des témoignages rapportés par la Commission interministérielle des marchés et travaux publics dans un rapport datant du… 11 juin 1909 ! A un moment où était en discussion de rendre obligatoire l'allotissement à une époque où l'accroissement du nombre de procédures de passation infructueuses inquiétait les pouvoirs publics. Une préoccupation qui là-aussi est de nouveau d'actualité (relire "Manque de concurrence dans les marchés de l’UE et faible participation des PME : la preuve par les chiffres ?")
Ainsi, l'allotissement est traversé par deux enjeux qui peuvent se révéler contradictoires. D’un côté, faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. De l’autre, privilégier l’efficacité et l’efficience dans la réalisation du projet.
Cet équilibre n’est donc toujours pas trouvé. D'autant que cette problématique peut se complexifier avec l'évolution des pratiques achats, et notamment avec le recours aux marketsplaces (lire "[Tribune] Vers un retour en grâce des marketplaces au sein de la commande publique ?").


Envoyer à un collègue
Offres d’emploi
Acheteur marchés publics (f/h)
- 11/09/2025
- CETIM - Centre Technique des Industries Mécanique
Gestionnaire marchés publics (f/h)
- 11/09/2025
- CETIM - Centre Technique des Industries Mécanique
- 10/09/2025
- Ville d'Argenteuil
Nouveaux documents
TA Polynésie française 28 juillet 2025 EURL Ha'aviti
-
Article réservé aux abonnés
- 19/09/25
- 07h09
TA Mayotte 29 juillet 2025 Préfet de Mayotte
-
Article réservé aux abonnés
- 18/09/25
- 07h09
TA Paris 21 juillet 2025 Centre Régional de Formation Professionnelle
-
Article réservé aux abonnés
- 17/09/25
- 07h09
Les plus lus
Marché public : une offre incomplète n’est pas systématiquement irrégulière
-
Article réservé aux abonnés
- 11/09/25 06h09
- Mathieu Laugier
Rendez-vous à 9h00 pour notre "direct" : achatpublic invite... Simon Uzenat
-
Article réservé aux abonnés
- 10/09/25 11h09
- Jean-Marc Joannès
Marché public : un candidat admissible à la négociation... évincé
-
Article réservé aux abonnés
- 12/09/25
- 06h09