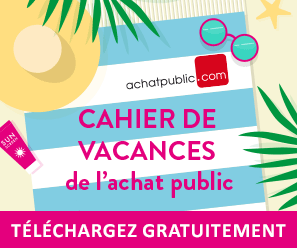Le nombre de marchés publics transfrontaliers peine à décoller
- 18/07/2008
Avec un score situé entre 1% et 2% dans l’Union européenne, le taux de marchés publics transfrontaliers peine à décoller. La Commission européenne mise sur la passation électronique de marchés pour inciter les entreprises à saisir les opportunités émanant d’autres États membres.

1% et 2%. C’est le taux de marchés publics situés au-dessus des seuils européens attribués à une entreprise établie dans un autre État membre que celui du pouvoir adjudicateur. Cette proportion infime de marchés publics transfrontaliers témoigne de la difficulté à voir émerger un véritable espace européen de la commande publique. La Commission européenne relativise et avance plusieurs explications à cette situation. Les 1% à 2% des marchés publics transfrontaliers sont à rapporter aux 1% d’entreprises européennes qui étaient, en 2003, responsables de 40% des exportations dans l’UE, selon une étude du think tank bruxellois Bruegel spécialisé dans les questions économiques internationales. S’il existe un problème d’internationalisation des entreprises européennes, il ne vise donc pas uniquement le secteur de la commande publique mais l’ensemble des secteurs économiques. Néanmoins, des exemples probants existent bel et bien : les timbres estoniens et slovènes sont par exemple imprimés en République tchèque. Est également évoquée « la myopie de l’indicateur ». Souvent, les entreprises disposent de structures légères dans un autre État membre, qui leur permettent d’être en contact étroit avec la réalité du terrain. Mais lorsqu’un appel d’offres est publié, bien souvent la maison mère se charge de la préparation de la réponse en lieu et place de sa filiale locale. Sans oublier que l’indicateur reste muet sur les contrats transfrontaliers dont les montants sont inférieurs aux seuils européens. Et pourtant il se passe des choses sous les seuils européens, surtout dans les régions transfrontalières. En témoigne le cas de cet architecte milanais qui a lancé un recours, et obtenu gain de cause, parce que la publicité portant sur un marché de seulement 30 000 euros lancé dans le cadre de l’implantation du Louvre à Lens n’avait été effectuée que dans des médias régionaux. Si elle regrette le manque de statistiques, la Commission comprend aussi qu’on ne puisse exiger des informations trop détaillées sans alourdir la charge administrative pesant sur les entreprises. En 2009, elle lancera une nouvelle étude pour affiner, par secteurs et dans le temps, son analyse sur les marchés publics transfrontaliers.
Mettre l’outil électronique au profit de la transparence
Afin d’améliorer la part des marchés publics transfrontaliers, l’outil électronique doit être constamment mis au profit d’une plus grande transparence des opportunités de marchés. Les directives de 2004 garantissent le principe selon l’accès aux marchés publics doit être non discriminatoire. « Les dispositions des directives sur les marchés publics électroniques donnent aux entreprises européennes le moyen de connaître l’existence d’un marché public dans l’UE et de décider si celui-ci est intéressant pour elles », souffle-t-on à la Commission. Sur cette base, plusieurs outils électroniques ont vu le jour et sont constamment améliorés. La base de données « TED » sur les opportunités de marchés situés au-dessus des seuils européens est continuellement enrichie de nouvelles fonctionnalités qui permettent à un soumissionnaire potentiel de trier l’information selon ses besoins. Le règlement n°1564/2005 établit treize formulaires standards pour la publication d’avis de marchés qui facilitent la compréhension des opportunités de marchés. Applicable à partir de septembre, le règlement n°213/2008 révise le vocabulaire commun pour les marchés publics(1) (CPV). « Il s’agit d’un des outils les plus sollicités par les opérateurs économiques », observe-t-on à la Commission. En cours de réalisation, le plan d’action européen sur les marchés publics électroniques contient plusieurs volets visant à assister les États membres dans une pratique « coordonnée » de la dématérialisation des marchés.
Figurent parmi les travaux la mise au point de spécifications techniques pour les catalogues électroniques et les attestations qu’un soumissionnaire doit fournir pour prouver son identité et ses capacités. Fin 2008, la Commission lancera également un plan d’action sur les signatures électroniques et proposera un cadre règlementaire pour la facturation électronique. Ces initiatives ont pour objectif « d’alléger la paperasserie » qui pèse sur les entreprises, indique la Commission. Sans pour autant imposer d’en haut des solutions qui ne seraient inadaptées aux besoins du terrain. C’est la raison pour laquelle, la Commission soutient aussi financièrement de nombreux projets de coopération transfrontalière réunissant des professionnels de la commande publique sur des questions concrètes. Citons par exemple : – le projet PEPPOL (« paneuropean public procurement online ») auquel participe la France ; – l’initiative ALPPS (« Alpine public procurement services ») qui ambitionne de faciliter l’accès d’entreprises allemandes, autrichiennes, françaises, italiennes et suisses aux marchés voisins ; – le consortium Procure où plusieurs régions européennes ont bâti une plate-forme électronique commune de passation de marchés sur le modèle de celle de la région Bourgogne. Ces projets pilotes font partie d’une stratégie d’ensemble : comprendre les difficultés concrètes auxquelles font face les professionnels pour orienter ensuite les travaux au niveau européen, explique-t-on à la Commission. Celle-ci évaluera en 2009 son plan d’action sur les marchés publics électroniques.


Envoyer à un collègue
Juriste conseil et contentieux de la commande publique (f/h)
- 02/09/2025
- Département des Hauts-de-Seine
Juriste affaires générales et achats publics (f/h)
- 02/09/2025
- Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence
Responsable finances et commande publique (f/h)
- 02/09/2025
- Ville du Pellerin
TA Cergy-Pontoise 2 juillet 2025 Société Le Vigilant Sécurité Privée
-
Article réservé aux abonnés
- 05/09/25
- 07h09
TUE 23 juillet 2025 BT Global Services Belgium
-
Article réservé aux abonnés
- 04/09/25
- 07h09
TA Melun 24 juin 2025 Société OSB
-
Article réservé aux abonnés
- 03/09/25
- 11h09
Validation d’un critère environnemental évaluant la politique générale des candidats à un marché public
-
Article réservé aux abonnés
- 02/09/25 06h09
- Mathieu Laugier
Acheteur public : un métier sous tensions, selon la Commission d’enquête du Sénat
-
Article réservé aux abonnés
- 03/09/25 06h09
- Jean-Marc Joannès
Attributaire déchu d’un marché public : le classement des soumissionnaires à revoir ?
-
Article réservé aux abonnés
- 04/09/25 06h09
- Mathieu Laugier
[Interview] - Laurent Dutertre : «L’IA n’est pas prête de remplacer l’acheteur»
-
Article réservé aux abonnés
- 01/09/25 06h09
- Johanna Granat