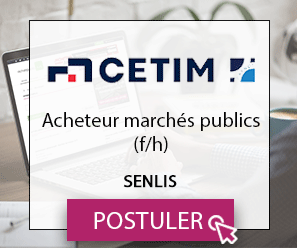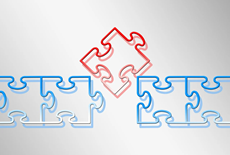Le B.A -BA de l’achat – Définition d’un marché public
Cet article fait partie du dossier :
Marché public
Acheteurs issus du privé, nouveaux praticiens de l’achat, étudiants, ou acheteurs désireux de reprendre les fondamentaux de l’achat public... Le B.A BA de l’achat, c’est une série de fiches synthétiques conçues à votre intention afin de faire le point sur les questions techniques de l’achat ou de (re)découvrir ensemble des notions courantes. Pour ce troisième numéro, la rédaction se penche sur la définition d’un marché public.

Nous avons tous en tête la définition donnée par l’article L.2 du code de la commande publique :
« Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Les contrats de la commande publique sont les mar

Abonnez-vous pour continuer votre lecture
15 jours gratuits sans engagement
Déjà abonné ? Connectez-vous.
Sur le même sujet


Envoyer à un collègue
Offres d’emploi
Acheteur marchés publics (f/h)
- 11/09/2025
- CETIM - Centre Technique des Industries Mécanique
Gestionnaire marchés publics (f/h)
- 11/09/2025
- CETIM - Centre Technique des Industries Mécanique
- 10/09/2025
- Ville d'Argenteuil
Nouveaux documents
TA Mayotte 29 juillet 2025 Préfet de Mayotte
-
Article réservé aux abonnés
- 18/09/25
- 07h09
TA Paris 21 juillet 2025 Centre Régional de Formation Professionnelle
-
Article réservé aux abonnés
- 17/09/25
- 07h09
CE 17 juillet 2025 Commune de Berck-sur-Mer
-
Article réservé aux abonnés
- 17/09/25
- 07h09
Les plus lus
Marché public : une offre incomplète n’est pas systématiquement irrégulière
-
Article réservé aux abonnés
- 11/09/25 06h09
- Mathieu Laugier
[Au plus près des TA] Quand la CAA s’intéresse à la déclaration sans suite
-
Article réservé aux abonnés
- 09/09/25 06h09
- Nicolas Lafay
Mercredi 24 Septembre : achatpublic invite... Simon Uzenat
-
Article réservé aux abonnés
- 10/09/25 11h09
- Jean-Marc Joannès